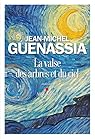Novembre 2016,
 Les vies de papier : un livre sur les livres. Mais pas que...
Les vies de papier : un livre sur les livres. Mais pas que...
Un livre touffu, roboratif, que j’ai trouvé passionnant ; des digressions déroutantes, des réflexions avisées, des anecdotes cocasses ; au final, une histoire émouvante, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Un roman pour les amateurs de littérature, une lecture qui exige de la patience.
La narratrice, Aaliya, soixante-douze ans, vit à Beyrouth depuis toujours, dans des conditions modestes. Elle vit seule dans un vieil appartement défraîchi.
Unique employée pendant cinquante ans d’une petite librairie, elle est entrée en littérature comme on entre dans les ordres. Elle a tenu entre ses mains des œuvres d’écrivains du monde entier – certains dont je n’avais jamais entendu parler, d’autres dont je connaissais le nom mais dont je n’ai rien lu –. Aaliya n’a pas beaucoup vendu, mais elle a tout lu et elle en parle ; une érudite de la littérature...
Elle parle aussi de la vie quotidienne à Beyrouth, le Beyrouth des quartiers populaires, en état de guerre permanent depuis sa jeunesse : guerre civile, guerre de religion, guerre tout court, bombardements, attentats, décombres, cadavres, rues barrées, incendies, coupures d'eau et d'électricité, restrictions alimentaires... Continuer à vivre !
Elle parle de la vieillesse ; le corps qui se délite, les douleurs qui s’installent, les frustrations de l’enfance qui, en dépit du temps, laissent des cicatrices mal refermées ; les menaces de l’inattention – laquelle peut se traduire par une couleur de cheveux inhabituelle !... Elle parle de l’isolement, de la solitude, qui n’en est pas le remède, car elle conduit à s’exclure, à s’enfermer.
Mais quel est le sens de tout cela, me direz-vous ? On ne fait pas un roman passionnant avec des considérations cérébrales aussi démoralisantes !... Patience, vous ai-je dit !
Aaliya est un roman à elle seule. Elle est traductrice. Mais qui le sait ?... Aaliya travaille selon un rituel et des règles propres à elle, qu’elle s’impose sans atermoiement. Elle traduit en arabe classique des ouvrages littéraires ... qui ne doivent en aucun cas être des œuvres originales écrites en français ou en anglais !... Mais elle ne connaît que l’arabe, le français et l'anglais ; elle ne comprend pas l’allemand, ni le russe, l’italien, le serbe ou que sais-je ! Elle travaille donc à partir des traductions françaises et anglaises des textes originaux !... Aaliya a ses raisons – ne comptez pas sur moi pour vous les dévoiler ! – Et c’est aussi « en toute logique » qu’une fois achevées, les traductions sont placées dans des cartons et entreposées chez elle, dans une ancienne salle d’eau...
Un jour, un incident technique conséquent la contraindra à se dévoiler à ses voisines – trois sorcières ! Catastrophe ou libération ?... Émotion.
Aaliya s’étend sur de multiples sujets. La musique classique, qu’elle connaît parfaitement. Les conditions de vie des femmes en Orient, leurs espoirs, leurs fantasmes, leurs amitiés. A ce propos, elle déclare avoir aimé deux femmes : Hannah, une amie, et Anna... – Karénine, bien sur. Étonnante homophonie.
En revanche, Aaliya entretient des rapports compliqués avec sa mère, très âgée. Elle raconte une histoire de pieds – un lavage et un massage de pieds – qui m’a dégoûté. (Non pas que je manque de compassion, mais personnellement je n'aime pas les pieds et j’ai horreur que l’on touche les miens, à la différence de ma femme qui ne jure que par la réflexologie plantaire.)
L’immanquable débat : la traduction doit-elle privilégier la fidélité littérale à l’original ou au contraire en adapter l’esprit. Cela me rappelle les polémiques soulevées, il y a une vingtaine d’années, par les publications d’une nouvelle génération de traducteurs de Dostoïevski et de Kafka.
La lecture de Les vies de papier est fluide et agréable, mais je me suis longtemps demandé où la narratrice cherchait à m’emmener. Tout s’assemble logiquement vers la fin. Il n’est pas inutile de relire certaines pages pour boucler la cohérence de l’ouvrage ; je veux dire : pour comprendre la cohérence d’Aaliya dans sa propre incohérence. Vous me suivez ?
Performance impressionnante de l’auteur, Rabih Alameddine. Cet homme parvient à se fondre totalement dans son personnage de femme, car quels que soient son mode de vie et ses bizarreries, Aaliya est bien une femme, avec des souvenirs de femme, des manies de femme et des problèmes de femme.
TRES DIFFICILE ooooo J’AI AIME PASSIONNEMENT

/image%2F1426270%2F20230713%2Fob_43d236_img-0417.jpeg)